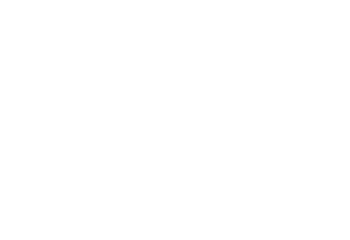Travailler dans un champ de tensions 2:
Ciblage et paradoxe de la reconnaissance
«Comme tout projet social, le projet de reconnaissance en général, et les projets concrets de reconnaissance en particulier, doivent être vus au travers des spécificités de leurs rapports avec les systèmes de pouvoir. Sitôt qu’elle se manifeste sous forme d’exigence ou d’intention concrète, la reconnaissance sociale exclut.» (Mecheril 2000)
Comme l’explique le texte 1.PF, l’exigence que, puisqu’ils sont un bien commun, les arts soient accessibles à tous les membres d’une société est l’une des motivations historiques de la médiation culturelle. Depuis quelques décennies, les institutions culturelles financées par les subventions publiques doivent de plus en plus étayer leur succès par des statistiques de visiteurs_euses ou la preuve qu’elles attirent un public pluriel. En même temps, la concurrence que leur font d’autres offres du domaine des loisirs et de la formation s’accentue. Ces raisons font, parmi d’autres, que des institutions culturelles, dont certaines n’érigent pas forcément la démocratisation des arts en priorité, adoptent une → orientation vers le public et cherchent à l’élargir par des offres de médiation qui s’adressent à des destinataires spécifiques. Des groupes qui ne font pas partie du public habituel de ces institutions et dont on pense qu’ils doivent être activement invités sont plus particulièrement ciblés. Il s’agit de groupes de population disposant d’un → capital culturel et économique relativement modeste et que l’on nommerait, d’un point de vue privilégié, «désavantagés» ou «culturellement défavorisés».
Le fait que des institutions culturelles s’adressent à de tels publics implique un champ de tensions que le pédagogue des migrations Paul Mecheril appelle le «paradoxe de la reconnaissance» en se référant à Hegel (→ Mecheril 2000). Le but de cette démarche – du moins en apparence – est de créer une égalité de droits ou, à défaut, d’en faire apparaître la possibilité. Pour s’adresser à un groupe, il faut toutefois l’avoir identifié et désigné. Or en le désignant, c’est l’altérité, et non l’identité, que l’on crée. Loin d’être fortuites ou neutres, ces identifications sont le fruit des perspectives et des intérêts de celui ou celle qui invite. Leur fonction est non seulement de fabriquer l’autre, mais également de légitimer sa propre norme comme celle à atteindre. L’expression «culturellement défavorisé_e» pose, par exemple, la question de la conception de la culture qui pousse à cataloguer des personnes comme étant «éloignées» de cette culture. Lorsqu’elle est citée dans le débat sur l’utilisation de la culture, l’expression «culturellement défavorisé_e» désigne, le plus souvent sans le dire expressément, un manque d’affinité pour le canon culturel bourgeois 1. Cette expression est donc utilisée par celles et ceux qui estiment que la culture qu’ils et elles possèdent est également bonne pour d’autres. Vue sous ce jour, l’«égalité» à laquelle l’on prétend dans ce cas, ainsi que dans bien d’autres, apparaît non pas tant comme une égalité des chances que le droit (à moins que ce ne soit un devoir?) de s’assimiler à la personne qui invite. S’agissant de l’accès au marché de l’emploi, «culturellement défavorisé_e» signifie l’absence de formation certifiée et de certificat de fin de scolarité. A cela, Erich Ribolits, spécialiste de l’éducation, objecte que «culture» ne veut justement pas dire compatibilité avec le marché du travail et propose, en lieu et place, le concept de «‹capacitation› […] à s’affirmer face aux contraintes que les rapports de force actuels imposent à la société». Les personnes formées selon ce concept s’opposeraient, dit-il, «à un totalitarisme faisant du travail et de la consommation les marqueurs de la réussite» et «ne verraient pas uniquement dans la nature un objet à exploiter et dans son prochain un concurrent» (→ Ribolits 2011). Dans cette optique, il y aurait lieu, selon Ribolits, de considérer une grande partie de la population comme «culturellement défavorisée». A ceci près que ce genre d’attitude, fait-il encore observer, existe dans les couches les plus diverses de la société, sans être liée à l’obtention de diplômes de fin d’études, à un niveau de formation élevé ou encore à des vues bourgeoises sur ce que devrait être la culture. Peut-être pourrait-on, grâce à ce concept, aller jusqu’à voir dans les connaissances et le savoir des personnes à faible capital culturel et économique (et qui ont, de ce fait, une capacité d’improvisation et de subversion particulièrement développée) la marque d’une élite culturelle.
Alors que le qualificatif de «culturellement défavorisé_e» est souvent utilisé pour identifier des publics-cibles mais jamais – et pour cause!– pour s’adresser explicitement à eux, il n’en va pas de même du qualificatif, toujours plus fréquent et en rien moins problématique, de «population issue de la migration». Au cours de la première décennie du XXIe siècle (et plus spécialement depuis l’attentat du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center de New York), le positionnement des institutions culturelles et les injonctions selon lesquelles elles doivent agir dans la → société migratoire sont devenus des questions centrales, ce dont témoigne une multitude de projets, d’études, de recommandations et de conférences2. Parce qu’il s’adresse surtout à des groupes bien déterminés, ethniquement et nationalement marqués comme étant les «autres», le terme «issus de la migration» utilisé par les médiateurs_trices culturel_le_s – d’ailleurs souvent en réaction aux exigences des politiques d’encouragement – ignore en l’occurrence l’immense pluralité et complexité des constructions identitaires des sociétés migrantes. En clair, l’on sous-entend ainsi que l’offre de médiation culturelle n’a pas vocation à intéresser à l’activité artistique des → expats bien payés, mais au contraire, des personnes «culturellement défavorisées», identifiées comme «issues de la migration. Mecheril, parmi d’autres, montre clairement que cette forme d’identification équivaut à culturaliser les injustices structurelles et sociales. Les effets des inégalités de traitement sociales, juridiques et politiques créées par les structures de la → société majoritaire ne sont pas thématisés. Au contraire, c’est la différence culturelle des invité_e_s, qui a été préalablement définie, qui devient le schéma interprétatif par lequel l’on explique leur absence des institutions. Dans ces conditions, comment s’étonner de l’agacement croissant que suscite ce qualificatif chez celles et ceux à qui l’on s’adresse (Mysorekar 2007) comme le montre p. ex. le descriptif de l’atelier «Antiracisme et travail culturel» proposé en automne 2011 par la → Tiroler Kulturinitative3:
«Il est aujourd’hui plus ou moins admis dans les contextes ‹critiques›, c’est-à-dire antiracistes, que le débat public sur l’immigration ne doit plus être centré sur les migrants, mais sur les problèmes sociétaux, qu’il ne doit plus parler de migrants ‹culturellement défavorisés› mais de la misère et des structures racistes du système éducationnel, qu’il ne doit plus avoir pour objet les migrants qui exploitent le système social mais les mécanismes qui excluent, etc. L’on constate par ailleurs que ce débat s’est fortement porté sur les migrants des pays musulmans. Alors que l’on parlait encore, il y a quelques années, de migrants qui avaient des parents ou des grands-parents turcs, c’est aujourd’hui des migrants musulmans dont il est question.
Les questions suivantes seront débattues, partant du fait que l’action culturelle construit un discours:
- En quoi l’action culturelle libre contribue-t-elle au débat sur l’immigration?
- Comment peut-on faire un travail culturel antiraciste sans faire référence au débat actuel sur la migration?
- Peut-on p. ex. faire des demandes de subventions sans que ce débat ne s’en empare?
- Pourrait-on se passer de l’appellation «migrant*»? Ou faire du travail antiraciste sans attributions identitaires?
- Comment l’action culturelle libre agit-elle par rapport au racisme dans le cadre de son propre travail et en dehors de celui-ci?
- Existe-t-il un lien entre l’action antiraciste et la répartition des ressources?
- Selon quels critères identifie-t-on le racisme?
- Selon quels critères identifie-t-on l’antiracisme?»
1 Un exemple parmi tant d’autres, datant du moment où ce texte a vu le jour: «C’est ainsi que quelques hautes écoles de musique germanophone proposent aujourd’hui des offres de formation initiale et continue à la médiation musicale censées préparer aux différents domaines d’activité des publics-cibles et qui vont des jeunes aux personnes âgées, d’‹autochtone› à ‹postmigrant› et de ‹culturellement favorisé› à ‹culturellement défavorisé›» (Wimmer 2012).
2 Quelques exemples: Rencontres: «inter.kultur.pädagogik», Berlin 2003; «Interkulturelle Bildung – Ein Weg zur Integration?» Bonn 2007; «Migration in Museums: Narratives of Diversity in Europe», Berlin 2008; «Stadt – Museum – Migration», Dortmund 2009; «MigrantInnen im Museum» Linz 2009; «Interkultur. Kunstpädagogik Remixed» Nuremberg 2012;
Recherche/Développement: «Creating Belonging», Zürcher Hochschule der Künste, soutenu par le FNS 2008–09; «Migration Design. Codes, Identitäten, Integrationen», Zürcher Hochschule der Künste, encouragé par la CTI 2008–2010; «Museums as Places for Intercultural Dialogue», projet de l’UE 2007–09; «Der Kunstcode – Kunstschulen im Interkulturellen Dialog», Bundesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen e.V. (BJKE), encouragé par le ministère allemand de l’Education et de la recherche 2005–2008, «Museum und Migration: Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund als Zielgruppe von Museen», Linzer Institut für qualitative Analysen (LIquA), sur mandat de la ville de Linz et du Land de Haute-Autriche, Département des affaires sociales et Institut pour l’art et la culture populaire 2009–2010. Publications et documents: Handreichung zum Schweizerischen Museumstag 2010; Allmanritter, Siebenhaar 2010; Zentrum für Audience Development der FU Berlin: Migranten als Publika von öffentlichen deutschen Kulturinstitutionen – Der aktuelle Status Quo aus Sicht der Angebotsseite, 2009; → http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/v/zad/news/zadstudie.html [16.4.2012].
3 L’atelier était dirigé par Vlatka Frketic.
4 Le terme «membres de la population majoritaire» s’applique dans ce texte à des citoyen_ne_s suisses sans distinction de région linguistique.
5 «Refuser les notions d’éternel féminin, d’âme noire, de caractère juif, ce n’est pas nier qu’il y ait aujourd’hui des Juifs, des Noirs, des femmes: cette négation ne représente pas pour les intéressés une libération, mais une fuite inauthentique» (Beauvoir 1968, p.9).
Bibliographie et webographie
Le texte se base en partie sur les publications suivantes: Autres références:- Allmanritter, Vera; Siebenhaar, Klaus (éd.): Kultur mit allen! Wie öffentliche deutsche Kultureinrichtungen Migranten als Publikum gewinnen, Berlin: B&S Siebenhaar, 2010
- Arts Council, England: A practical Guide to working with Arts Ambassadors, Londres: Arts Council, 2003 [12.10.2012]; → MFV0209.pdf
- Castro Varela, Maria do Mar: Interkulturelle Vielfalt, Wahrnehmung und Selbstreflexion aus psychologischer Sicht (s.d.) [12.10.2012]; → MFV0210.pdf
- Gülec, Ayse et al.: Kunstvermittlung 1: Arbeit mit dem Publikum, Öffnung der Institution, Zurich: Diaphanes 2009
- Kilomba, Grada: «Wo kommst du her?», Heinrich Böll Stiftung, Dossier Schwarze Community in Deutschland (s.d.) [16.8.2012]; → MFV0208.pdf
- Mecheril, Paul: Anerkennung des Anderen als Leitperspektive Interkultureller Pädagogik? Perspektiven und Paradoxien, Vortragsmanuskript zum interkulturellen Workshop des IDA-NRW 2000 [14.10.2012]; → MFV0201.pdf
- Mysorekar, Sheila: «Guess my Genes – Von Mischlingen, MiMiMis und Multiracials», dans: Kien Nghi Ha et al. (éd.): re/visionen – Postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland, Münster: Unrast, 2007, pp.161–170
- Ribolits, Erich: «Wer bitte ist hier bildungsfern? Warum das Offensichtliche zugleich das Falsche ist», dans: HLZ, Zeitschrift der GEW Hessen, no9/10, 2011 [12.10.2012]; → MFV0202.pdf
- Spivak, Gayatri Chakravorty: «Can the Subaltern Speak?», dans: Nelson, C.; Grossberg L. (éd.), Marxism and the Interpretation of Culture, Basingstoke: Macmillan, 1988, pp.271–313
- Terkessidis, Mark: «Im Migrationshintergrund», dans: der freitag 14.1.2011 [15.2.2013]; → MFV0206.pdf
- Wimmer, Constanze: «Kammermusik-Collage oder Babykonzert – von den vielfältigen Wegen der Musikvermittlung» dans: KM. Das Monatsmagazin von Kulturmanagement Network Kultur und Management im Dialog, no 67, mai 2012, p.15 [25.8.2012]; → MFV0211.pdf
- Winter Saylir, Sara: «‹Wo kommst du her?› – ‹Aus Mutti›. Antirassismustraining für Europa», dans: WOZ Die Wochenzeitung, no31, 14.11.2011→ MFV0207.pdf