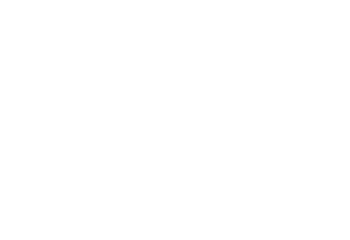Travailler dans un champ de tensions 1:
La médiation culturelle entre émancipation et apprentissage de la discipline
«Il n’existe guère [en allemand] de verbe que l’on ne puisse construire, pour des raisons pratiques ou par plaisanterie, avec le préfixe ‹ver-›, lequel indique toujours un mouvement s’éloignant du locuteur, c’est-à-dire une perte [comme dans Verlust, où le ‹ver-› transforme le plaisir et l’envie en perte].» (Mauthner 1913)
«Je me suis aperçu que l’initiation consistait à inquiéter les gens et à ne rien leur apprendre.» (Caillet 1995)
La médiation culturelle – et plus particulièrement la médiation des arts – n’est pas (seulement) une communication, une explication et une description, ni un transfert de savoirs opéré par des spécialistes et supposé être le plus lisse possible, d’un être censé maîtriser un savoir vers un être censé l’ignorer. Inhérente à la médiation, la controverse de savoir à qui reviennent le droit et le loisir de posséder les arts, d’en jouir, de les donner à voir et d’en parler est presque aussi ancienne que l’art lui-même. Certaines lettres de Pline, écrites au début du premier millénaire de l’ère chrétienne, montrent que l’on débattait déjà publiquement du fait de savoir si une collection d’œuvres d’art pouvait être privée et soustraite au public ou si elle devait, au contraire, lui être accessible. (Wittlin 1949, p.109). À l’ère moderne, de nouveaux besoins sont nés, issus des bouleversements de la Révolution française et de l’industrialisation. Ils se sont traduits par la création des musées publics et, peu après, par la pratique de la médiation muséale, mise au service des objectifs suivants: justifier la possession par les États de biens culturels spoliés dans le cadre de guerres et de la colonisation; diffuser des mythes fondateurs visant à développer le sentiment national dans la population; mettre aux normes bourgeoises des couches ouvrières toujours plus nombreuses; promouvoir la formation esthétique, au sens d’un apprentissage de capacités créatrices et d’une formation du goût, pour contribuer à la compétitivité économique mondiale et coloniale; mais aussi démocratiser l’éducation et la formation ainsi que – comme cela se pratiquait déjà – les arts en tant qu’éléments de la vie publique auxquels tous les membres d’une société ont droit (Sturm 2002b, p.199 sqq.).
Dans cet esprit, au XIXe siècle, l’Angleterre fit des musées des lieux de formation pour les écoles et, après l’exposition universelle de 1851, également pour les adultes. Ainsi virent le jour des «Philanthropic Galleries», dans lesquelles des réformateurs_trices sociaux_ales, des hommes d’église et des artistes utilisaient peintures et sculptures comme des moyens d’inculquer aux plus démuni_e_s et aux ouvriers_ères des fabriques les vertus de la bourgeoisie, en présentant les arts comme une partie intégrante d’une vie réussie, transcendant les classes sociales et les origines (→ Mörsch 2004a). Bon nombre de ces galeries, par exemple la South London Gallery, étaient issues des → Working Men Colleges, c’est-à-dire d’institutions du mouvement ouvrier. Né de la «Reformpädagogik» (Éducation nouvelle), la «Kunsterziehungsbewegung», mouvement allemand pour l’enseignement artistique, propageait au début du XXe siècle la nécessité pédagogique de la liberté d’expression individuelle. Sous son influence et dans le cadre de l’éducation populaire, des approches de la médiation de la musique, du théâtre et des arts plastiques ont été développées sur le plan international – une médiation qui était vue comme un apprentissage de la réception d’œuvres d’art et une occupation destinée au public amateur. Or, à l’époque pas plus qu’aujourd’hui, la «liberté d’expression» n’était synonyme de liberté d’objectifs. De même que dans «Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reyhe von Briefen» [Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme] (Berghahn 2000), sa publication de 1801, Friedrich Schiller concevait l’éducation esthétique comme un outil permettant à l’individu de développer sa personnalité en évitant de s’opposer avec violence au pouvoir en place, les écrits de la Kunsterziehungsbewegung articulaient également des objectifs précis: «Car le renouvellement de la formation artistique de notre peuple est, aux niveaux éthique, politique et économique, l’une des questions vitales qui se pose à nous», écrivait Alfred Lichtwark, directeur de la Hamburger Kunsthalle – qui passe pour le fondateur de la médiation culturelle muséale allemande – dans son essai «Der Deutsche der Zukunft» [L’Allemand du futur]. Cet essai, paru en 1901 à Dresde, à l’occasion de la première journée de l’éducation artistique, fait apparaître la médiation culturelle comme un moyen de mettre en valeur un pays en tant que nation qui investit dans l’économie et la culture. Ce que corrobore une étude historique de 2005, qui montre de façon exemplaire que le colonialisme se servait de l’éducation esthétique pour imposer les valeurs et les modes de gouvernance européens (Irbouh 2005). Parallèlement se développaient des concepts d’une médiation culturelle placée sous le signe d’une émancipation de type marxiste, et Walter Benjamin rédigeait pour le travail théâtral avec des enfants et des jeunes un programme où transparaît toute l’influence du théâtre pour enfants prolétariens d’Asja Lacis (Benjamin 1977, p.764 sqq.).
La lutte contre l’exclusion culturelle est depuis ses débuts une revendication et un objectif jamais atteint de la médiation culturelle. Issu d’un milieu pauvre, Lichtwark avait l’ambition de rendre la formation artistique accessible à toutes les couches de la population, mais c’est avec des élèves de l’école supérieure de jeunes filles qu’il réalisa ses exercices sur la lecture des œuvres d’art (Lichtwark 1897). Les écoles d’art libres («Freie Kunstschulen») créées depuis les années 1960 en Allemagne, de même que les ateliers créatifs des centres communautaires zurichois s’adressent aujourd’hui encore à une clientèle en règle générale plutôt choisie, surtout par comparaison avec des offres socioculturelles qui ne mettent pas l’accent sur l’art. Débutant dans les années 1950, les efforts français de décentralisation et de popularisation du théâtre contemporain ont certes profondément changé le paysage théâtral du pays, mais très peu modifié la composition du public (Duvignaus 1986, p.64; Berardi, Effinger 2005, p.75 sqq.). De même, les offres de médiation du domaine de la musique classique n’atteignent à ce jour qu’un public presque entièrement composé d’habitué_e_s. (→ Aicher 2006). Quant aux hautes écoles d’art et de musique, elles constituent pour l’heure le lieu de formation tertiaire le plus select d’Europe: même les universités n’exigent pas de la part des candidat_e_s un bagage préalable représentant un → capital symbolique ou économique d’une telle ampleur (→ Seefranz, Saner 2012). Et cela alors même qu’il s’agit d’établissements qui prétendent ériger le «don» en seul critère de sélection – un concept que l’on considère généralement comme libre de toute considération d’origine sociale ou nationale.
Les notions de «culture» et d’«art» ne sont donc pas neutres, mais lourdes de normes et, par conséquent, d’enjeux. Est réputé «cultivé_e», au sens où l’entend le sociologue Pierre Bourdieu (Bourdieu 1983), celui ou celle qui possède une mélange particulier de goût et de savoir, un mélange qui se reconnaît par exemple à la connaissance des arts et du design, à la consommation de denrées fines, à la façon d’utiliser son corps et celui des autres ou aux codes vestimentaires et au style de communication. Ce qui entre dans la panoplie de la personne cultivée est soumis à des transformations avec, toutefois, une constante: le fait que le mot «culture» signifie ici l’affirmation et la distinction de styles de vie qui sont socialement reconnus. Ce mot est aussi utilisé, en lien avec une conception du monde marquée par le colonialisme, dans une acception ethniquement démarcative, au sens d’une culture «propre», «étrangère» ou «autre»1. Bourdieu a publié «La distinction. Critique sociale du jugement» en 1979. Nombreux_ses sont néanmoins les chercheurs_euses qui se réclament de lui. Car, pour anciennes et connues qu’elles soient, les deux fonctions de délimitation – celle qui sépare les couches sociales et celle qui cherche à distinguer entre le soi-disant «soi» et le soi-disant «autre» – sont toujours agissantes. C’est dans cet esprit qu’il faut lire les initiatives qui proposent de conserver le concept de culture, mais en le débarrassant des fonctions de distinction décrites ci-dessus. Depuis les années 1920, l’idée d’un concept de la culture élargi, englobant des pratiques journalières et des phénomènes «populaires», est défendue en France par l’éducation populaire et en Angleterre, à partir des années 1950, par les Cultural Studies. Elle l’est également au Brésil, par la pédagogie de la libération (Freire 1974). Selon cette conception, la pratique culturelle, tout comme son exploration et sa médiation, ont vocation à soutenir le combat contre les inégalités au lieu de les pérenniser et de les reproduire, inégalités que l’on constate par exemple au niveau des conditions économiques ou en lien avec des catégories telles que le genre, l’ethnicité ou la nationalité. C'est dans cette tradition que s’inscrivent également, depuis les années 1970, certains courants de la pédagogie culturelle et de → l’animation socioculturelle
des espaces germanophone et francophone ainsi que la pratique d’artistes qui sont actifs_ves dans les écoles et les établissements de formation informelle (→ Mörsch 2005). En même temps s’élève, surtout dans le monde anglo-saxon et anglo-américain, l’exigence d’une visibilité et d’une participation des minorités au travail artistique, portée par les mouvements des droits civiques et des artistes, – une exigence dont la réalisation est activement soutenue par les acteurs_trices de la médiation culturelle (→ Allen 2008).
Au vu du champ de tensions très succinctement évoqué ci-dessus, né de parcours historiques différents, il n’y a rien d’étonnant à ce que la médiation culturelle soit une pratique hétérogène, susceptible de positionnements très différents selon les buts qu’elle poursuit et la conception des arts et de la formation qu’elle défend. Quand son rôle consiste principalement à augmenter le public d’institutions culturelles qui ont pignon sur rue, elle est proche du marketing. Mais lorsqu’elle se conçoit d’abord comme un système de formation au sens qu’en donne la société civile d’un pays démocratique et/ou au sens artistique du terme, c’est alors la dimension pédagogique, c’est-à-dire le fait d’initier et d’animer des débats ou de diriger et d’accompagner des processus artistico-créatifs qui prend le dessus. Si son but est surtout d’être au service du développement économique, en encourageant par exemple des industries dites créatives, elle pourra, le cas échéant, obéir à des logiques entrepreneuriales. Si elle entend combattre des structures génératrices d’inégalités, elle se trouvera en interaction avec le travail social ou l’activisme. Mais elle peut tout aussi bien se concevoir comme une pratique artistiquement informée, et ce d’autant plus que des artistes prennent une part déterminante à → l’établissement de la médiation culturelle en tant que pratique, et qu’ils ont aidé à la façonner (Mörsch 2004a). Quel que soit le domaine sur lequel est mis l’accent, il est dans la nature de la médiation culturelle institutionnalisée de se trouver dans une situation d’ambivalence. Dans la mesure où elle leur amène du public et défend leurs intérêts vis-à-vis de l’extérieur, elle sert à stabiliser et à légitimer les institutions culturelles. Or, par le simple fait que son existence rappelle la promesse jamais pleinement tenue de considérer les arts comme un bien public, elle est aussi un irritant permanent. Cette fonction d’admonition, cette propension à produire de la différence au sein du système n’est peut-être pas étrangère au fait que son statut soit souvent → précaire et qu’il soit la plupart du temps rattaché aux échelons inférieurs de la hiérarchie institutionnelle. D’où le haut degré de → féminisation de la médiation culturelle. Une médiation laquelle, qui plus est, est régulièrement soupçonnée par le camp des artistes de trahir l’art – par exemple, au motif que le discours sur les arts diffère du discours spécialisé. Ou parce que la médiation fait qu’apparaissent dans le champ artistique des gens dont la présence en interrompt la routine et qui le renvoient soudainement à son propre fonctionnement.
À partir de la seconde moitié des années 1990, des concepts de médiation faisant de la production de différences et de l’impossibilité de remplir sa mission un point de départ productif de sa pratique ont été développés en réponse à ces tensions. En 1994 voit le jour à l’Université Aix-Marseille, sur demande du ministère français de la Culture et sur la base d’une enquête sur les besoins, le cursus «Médiation Culturelle des Arts». Le responsable en était jusqu’à 2006 → Jean-Charles Bérardi, sociologue de l’art, un homme qui se réfère notamment à Pierre Bourdieu et à des études qui reposent sur ses travaux. Selon lui, la médiation culturelle des arts est un champ d’activité politique. Une activité qui consiste à exiger que les institutions culturelles soient reconnues comme des espaces publics. Il ne s’agit pas, en l’occurrence, de rendre moins vive la tension entre l’art et le public, mais d’en faire, au contraire, le point de départ et le contenu de débats. La médiation culturelle des arts devrait notamment s’interroger sur la pertinence que les arts ont pour la société et, inversement, sur la pertinence de la société pour les arts (Bérardi, Effinger 2005, p.80). Cette conception de la médiation culturelle des arts est fortement imprégnée de linguistique et, en particulier, des thèses du psychanalyste Jacques Lacan (Effinger 2001, p.15). Selon celles-ci, le fait de parler de l’art ne peut que générer un manque, car la langue ne coïncide jamais avec ce à quoi elle renvoie. Il subsiste toujours un reste intraduisible, qui ne peut être dit. Mais un reste qui, pour Lacan, est productif. Il est le fondement de la construction du moi, de la perception de l’altérité et, partant, de la fabrication continue de symboles. Jean Caune, l’un des grands théoriciens de la médiation culturelle française, parle à ce propos d’une «brèche» (Caune 1999, p.106 sqq.) par laquelle se profile l’altérité, jamais entièrement compréhensible. L’impossible exigence visant à réparer la rupture entre l’art et la société par des explications et en rendant l’art accessible, lui apparaît, vue sous ce jour, comme le fondement nécessaire à la compréhension de la médiation culturelle. Il ne conçoit pas cette dernière comme une transmission d’informations mais comme un acte performatif, comme un processus permettant de fabriquer du lien entre les parties prenantes (par exemple, entre médiateurs_trices et public), entre les supports d’expression (par exemple, les œuvres d’art) et entre les structures sociétales (par exemple, les institutions culturelles). Ce en quoi Elisabeth Caillet, autre grande figure de la médiation culturelle française, voit un parallèle avec la relation complexe que l’artiste entretient avec l’œuvre d’art et le monde (Caillet 1995, p.183). Médiatrice artistique et théoricienne, Eva Sturm a développé de son côté, à l’usage du monde germanophone, une méthode qui correspond à cette vision. Intitulé «Im Engpass der Worte. Sprechen über moderne und zeitgenössische Kunst» (Sturm 1996), que l’on pourrait traduire par «Là où les mots se rétrécissent. Comment parler de l’art moderne et contemporain», son livre a eu un fort retentissement sur la médiation artistique en langue allemande. L’auteure y analyse, avec Lacan, elle aussi, les actes langagiers que la médiation artistique produit dans les musées. La «brèche» de Caune est chez elle le «Lücken reden», «une énonciation de lacunes» (Sturm 1996, p.100), et la médiation artistique devient un acte performatif de traduction par lequel quelque chose se perd et quelque chose de nouveau s’ajoute, produisant ainsi un élément tiers, qui n’est jamais identique au contenu à traduire. Pour elle aussi la médiation n’est donc ni explication ni conciliation. Réalisant le potentiel de privation du préfixe «ver-» évoqué en introduction à ce chapitre, la Ver-mittlung, autrement dit la médiation, est imbroglio, perte de contrôle et acte manqué au profit de réseaux relationnels et d’espaces d’action (pas toujours) gérables.
Outre l’irritant systémique décrit ci-dessus, dont nous avons montré que, tel un symptôme, il a toujours accompagné la médiation culturelle institutionnelle, des concepts présentant la médiation artistique comme une pratique critique de l’hégémonie culturelle, comme une rupture et une contre-canonisation consciente et voulue ont vu le jour au cours de la dernière décennie, s’inspirant des mouvements des années 1970 et 1980 évoqués plus haut (Marchardt 2005; Mörsch et al. 2009; Graham, Shadya 2007; → Rodrigo 2012, Sternfeld 2005). Par hégémonie, il faut entendre dans ce contexte les rapports de pouvoir qui prédominent dans les démocraties capitalistes occidentales, c’est-à-dire des rapports de pouvoir fondés sur un consensus sociétal et non imposés de force (Haug, Gramsci 2004, p.3). Ce consensus est bâti sur des idées qui paraissent être vraies et normales à la majorité des citoyen_ne_s. Les membres de la société acceptent l’ordre hégémonique et vivent selon ses règles et ses codes (Demirovic 1992, p.134). Mais le consensus sur lequel repose l’ordre hégémonique fait l’objet de convoitises qui obligent à le renégocier sans cesse. Aussi la critique de l’hégémonie en vient-elle à faire également partie de l’ordre hégémonique. Elle ne peut donc pas prétendre être extérieure à ce qu’elle critique, car elle tend à devenir elle-même hégémonique et à représenter le consensus de la société. Tel est le point d’ancrage d’une forme de médiation culturelle dont la critique des structures hégémoniques fonde la pratique. Les institutions culturelles et la production artistique sont parmi les principaux lieux où se négocie l’ordre hégémonique. De par ce qu’elles ont à offrir, de par la forme que prend leur offre, mais aussi de par leurs conditions de travail, leur économie, leurs espaces d’action et les caractéristiques de leur visibilité, ces institutions sont en permanence des parties prenantes de la fabrication et de la confirmation des normes et des valeurs de la société, des inclusions et des exclusions, du pouvoir et du marché, mais potentiellement aussi de leur remise en question et de leur modification. Or la médiation culturelle n’est pas uniquement ancrée dans la production culturelle, elle l’est aussi dans la pédagogie, cet autre lieu de fabrication, de critique et de transformation des structures hégémoniques. Aussi se trouve-t-elle placée, quel que soit le cas de figure, devant le choix de confirmer et de reproduire les structures hégémoniques existantes ou de s’en distancier et de les transformer. Si elle choisit de les transformer, cela l’oblige tout d’abord à se contredire elle-même (Haug F. 2004, p.4–38), à regarder en face les évidences jamais remises en question de sa propre pratique, à analyser ses normes et ses valeurs cachées. Cette médiation critique entend par ailleurs transformer les institutions et les conditions dans lesquelles elle s’exerce. Une critique qui ne proposerait rien serait, de par son autosuffisance, contraire aux revendications de la médiation à instaurer des → situations d’échanges – des échanges qui ne seraient certes pas toujours harmonieux, mais dans lesquels les antagonismes et les résistances auraient toute leur place. (Sturm 2002)2. Une médiation culturelle qui se conçoit comme une pratique critique, au sens indiqué ici, essaie en outre de repenser et de vivre autrement les raisons qui la fondent. Se contredire suppose un projet basé sur l’approbation (Haug F. 2004, p.4–38).
Les textes pour flâneurs_euses qui suivent s’intéressent au double mouvement d’une médiation culturelle qui se développe entre la critique et la refonte de sa propre pratique. Ils s’articulent autour d’une question centrale par chapitre. Ils présentent d’abord, sous l’angle de la critique des structures hégémoniques, le champ de tensions dans lequel se meut la médiation culturelle en lien avec chacune de ces questions. Ils réfléchissent ensuite aux possibilités d’action et de transformation qui naissent de chaque champ de tensions. La première des boucles suivantes – où les possibilités d’action qui résultent de cette réflexion sont remises en question quant à leur propre hégémonisme, et aux pratiques de pouvoir ainsi qu’aux contradictions dont cet hégémonisme s’accompagne – n’est mentionnée dans les textes que pour dire que les tensions existantes ne peuvent être résolues, mais qu’il s’agit de travailler en leur sein, en en faisant un usage informé et conscient.
1 «Cette conception globale de la culture […] doit la forme qu’on lui connaît aujourd’hui à Johann Gottfried Herder, et plus précisément aux Idées pour une philosophie de l’histoire de l’humanité, qu’il a publiées entre 1784 et 1791. La conception herdérienne de la culture est caractérisée par trois temps: le fondement ethnique, l’homogénéisation sociale et la délimitation par rapport à l’extérieur.» (Welsch 1995)
2 À noter que celles et ceux qui développent et réalisent des propositions d’action ne doivent pas forcément être ceux qui en font l’analyse.
Bibliographie et webographie
Le texte se base en partie sur les publications suivantes:
- Mörsch, Carmen (2004a): «Socially Engaged Economies: Leben von und mit künstlerischen Beteiligungsprojekten und Kunstvermittlung in England», dans: Texte zur Kunst, no53, mars 2004, «Erziehung» [14.10.2012]; → MFV0101.pdf (Mörsch 2004a)
- Mörsch, Carmen: «Watch this Space! – Position beziehen in der Kulturvermittlung», dans: Sack Mira et al. (éd.): Theater Vermittlung Schule (subTexte 05), Zurich: Institute for the Performing Arts and Film, 2011
- Aicher, Linda: Kinderkonzerte als Mittel der Distinktion. Soziologische Betrachtung von Kinderkonzerten in Wien anhand von Pierre Bourdieus kultursoziologischem Ansatz, Vienne: Wirtschaftsuniversität, Schriftenreihe 2. Forschungsbereich Wirtschaft und Kultur, 2006 [25.7.2012]; → MFV0102.pdf
- Allen, Felicity: «Situating Gallery Education», dans: Tate Encounters [E]dition 2: Spectatorship, Subjectivity and the National Collection of British Art, février 2008 [25.7.2012]; → MFV0106.pdf
- Benjamin, Walter: «Programm eines proletarischen Kindertheaters», dans: Benjamin, Walter: Œuvres complètes, volume 2/2, Francfort-sur-le-Main: Suhrkamp, 1977
- Bérardi, Jean-Charles; Effinger, Julia: «Kulturvermittlung in Frankreich», dans: Mandel, Birgit (éd.): Kulturvermittlung zwischen kultureller Bildung und Kulturmarketing, Bielefeld: Transcript, 2005
- Berghahn, Klaus (éd.): Friedich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen. Mit den Augustenburger Briefen, Stuttgart: Reclam, 2000
- Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede, Francfort-sur-le-Main: Suhrkamp, 1983
- Caillet, Elisabeth: A l’approche du musée, la médiation culturelle, Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1995
- Caune, Jean: Pour une éthique de la médiation. Le sens des pratiques culturelles, Grenoble: Pug, 1999
- Demirovic, Alex: «Regulation und Hegemonie: Intellektuelle, Wissenspraktiken und Akkumulation», dans: Demirovic, Alex et al. (éd.): Hegemonie und Staat: Kapitalistische Regulationen als Projekt und Prozess, Münster: Westfälisches Dampfboot, 1992, pp.128 – 157
- Duvignaud, Jean; Lagoutte, Jean: Le théâtre contemporain – culture et contre-culture. Paris: Larousse, 1986
- Effinger, Julia: Médiation Culturelle: Kulturvermittlung in Frankreich. Konzepte der Kulturvermittlung im Kontext von Kultur- und Theaterpolitik, thèse de diplôme de la formation Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis, Université d’Hildesheim, 2001
- Freire, Paulo: Erziehung als Praxis der Freiheit, Stuttgart: Kreuz, 1974
- Graham, Janna; Shadya, Yasin: «Reframing Participation in the Museum: A Syncopated Discussion», dans: Pollock, Griselda; Zemans, Joyce: Museums after Modernism: Strategies of Engagement, Oxford: Blackwell, 2007, pp.157–172
- Haug, Frigga: «Zum Verhältnis von Erfahrung und Theorie in subjektwissenschaftlicher Forschung», dans: Forum Kritische Psychologie 47, 2004, pp.4–38
- Haug, Wolfgang Fritz: «Hegemonie», dans: Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus, Hambourg: Argument, 2004, pp.1–25
- Irbouh, Hamid: Art in the Service of Colonialism: French Art Education in Morocco, 1912–1956, New York: Tauris Academic Studies, 2005
- Lichtwark, Alfred: Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken: Nach Versuchen mit einer Schulklasse herausgegeben von der Lehrervereinigung zur Pflege der künstlerischen Bildung, Dresden: G. Kühtmann, 1900 (première édition 1897)
- Marchart, Oliver: «Die Institution spricht. Kunstvermittlung als Herrschafts- und als Emanzipationstechnologie», dans: Jaschke, Beatrice et al. (éd.): Wer spricht? Autorität und Autorschaft in Ausstellungen, Vienne: Turia und Kant, 2005, pp.34–58
- Mauthner, Fritz: Sprache und Grammatik. Beiträge zu einer Kritik der Sprache, volume III, Stuttgart/Berlin: J.G. Cotta, 1913
- Mörsch, Carmen (2004b): «From Oppositions to Interstices: Some Notes on the Effects of Martin Rewcastle, the First Education Officer of the Whitechapel Gallery, 1977–1983», dans: Raney, Karen (éd.): Engage no15, Art of Encounter, Londres, 2004, pp.33–37
- Mörsch, Carmen und das Forschungsteam der documenta 12 Vermittlung: Kunstvermittlung 2. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 12, Zurich: Diaphanes, 2009
- Rodrigo, Javier: «Los museos como espacios de mediación: políticas culturales, estructuras y condiciones para la colaboración sostenible en contextos», dans: LABmediació del CA Tarragona Obert per Reflexió: un Laboratori de treball en xarxa i producció artística i cultural, Tarragona: CA Centre d’Art Tarragona, Ajuntament de Tarragona, 2012, pp.43–39; (texte original en catalan, traduction espagnole) [14.10.2012]; → MFV0107.pdf
- Seefranz, Catrin; Saner, Philippe: Making Differences: Schweizer Kunsthochschulen. Explorative Vorstudie, Zurich: IAE [25.7.2012]; → MFV0103.pdf
- Sternfeld, Nora: «Der Taxispielertrick. Vermittlung zwischen Selbstregulierung und Selbstermächtigung», dans: Jaschke, Beatrice et al. (éd.): Wer spricht? Autorität und Autorschaft in Ausstellungen, Vienne: Turia und Kant, 2005, pp.15–33
- Sturm, Eva: Im Engpass der Worte. Sprechen über moderne zeitgenössische Kunst, Berlin: Reimer, 1996
- Sturm, Eva (2002a): «Woher kommen die KunstvermittlerInnen? Versuch einer Positionsbestimmung», dans: Sturm, Eva; Rollig, Stella (éd.): Dürfen die das? Kunst als sozialer Raum: Art/Education/Cultural Work/Communities, Vienne: Turia und Kant, 2002, pp.198–212
- Sturm, Eva (2002b): «Kunstvermittlung als Widerstand», dans: Schöppinger Forum der Kunstvermittlung. Transfer. Beiträge zur Kunstvermittlung no2, 2002, pp.92–110
- Welsch, Wolfgang: «Transkulturalität. Die veränderte Verfasstheit heutiger Kulturen», dans: Institut für Auslandsbeziehungen (éd.): Migration und Kultureller Wandel, Schwerpunktthema der Zeitschrift für Kulturaustausch, 45e année 1995/1er trimestre, Stuttgart 1995 [27.7.2010]; → MFV0104.pdf
- Wittlin, Alma: The Museum: its History and its Taks in Education, Londres/New York: Routledge, 1949
- Working Men Colleges [14.10.2012]